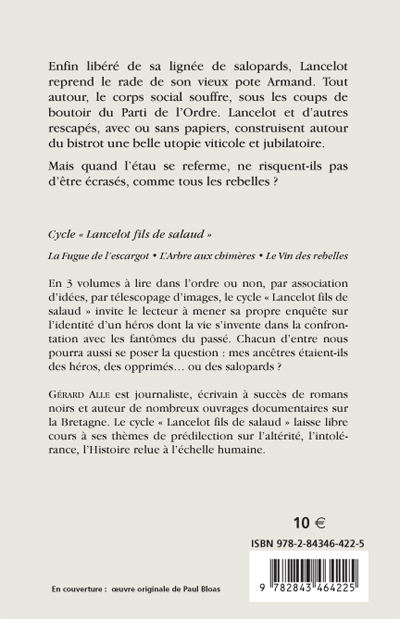|

Bistrot
Le
matin de l’ouverture, il pleuvait encore, il pleuvait toujours,
il pleuvait entre deux averses, un de ces crachins qui vous colle
à la peau et vous rouille les nerfs. Juste avant midi, histoire
d’attaquer tout de suite dans le mou du sujet, j’ai
vu atterrir, pliés sous le grain, un couple de cormorans
neurasthéniques à la recherche d’un abri. Mes
premiers clients. Deux vieux à casquette. Le père
Lozac’hmeur et son cousin René. Pas compliqué.
Comme Armand, je le connaissais par cœur, Lozac’hmeur,
et je savais qu’il lui fallait un p’tit jaune, une gitane
maïs au coin du museau, un carnet pour tout noter, ne pas omettre
de lui glisser un petit mot sur le temps qu’il fait, l’écouter
dire l’heure qu’il est, et c’est pas l’tout,
mais va falloir y aller. Où ça ? J’sais pas.
Houlala ! On appelait ça « la maladie de Lozac’hmeur
». Il notait tout. Il oubliait au fur et à mesure qu’il
notait. Et il oubliait où il avait mis les carnets où
il avait tout noté.
Le représentant de chez Ricard venait de m’apporter
des doseuses, pour limiter les dégâts. Avant, y’en
avait pas. Fallait bien que j’imprime ma marque ! Les deux
anciens m’ont regardé placer le verre en dessous de
l’implacable juge de paix, sans rien dire. Ha ! Ha ! Fini
le coup de poignet généreux, place à la rigueur
scientifique du dosage millimétré !
Mais ils avaient à peine trempé les lèvres
dans leur p’tit jaune, que le René m’a lancé,
comme ça, l’air de rien :
- Il a un drôle de goût, ton Ricard.
Et Lozac’hmeur, il a ajouté :
- C’est vrai, ça. Il a un drôle de goût.
- Un goût de quoi ? que je leur ai demandé, estomaqué.
Hum… Le René a fait mine de réfléchir,
avant de lâcher :
- Un goût de caoutchouc.
Un goût de caoutchouc ? Alors là, j’en revenais
pas ! Et Lozac’hmeur, il a renchéri :
- Oui, c’est ça. Un goût de caoutchouc.
Je l’observais sous toutes les coutures, je le décortiquais,
le père Lozac’hmeur, ce maniaque, cet ancien contrôleur
des services vétérinaires, caché sous son béret,
qui notait méticuleusement, la bave aux lèvres, dans
son carnet : Aujourd’hui, le petit jaune a un goût de
caoutchouc. La France en avait fabriqué des palanquées,
d’inspecteurs, de contrôleurs de cette espèce,
plus ou moins flics, plus ou moins collabos. Ah ! Je mourrais d’envie
de l’arracher, sa saleté de langue qui lui pendouillait
au coin des lèvres, j’en rêvais, mais j’ai
goûté le breuvage à mon tour, pour montrer ma
bonne volonté. C’était vraiment n’importe
quoi cette histoire de caoutchouc, mais fallait surtout pas que
je les contredise, sinon j’étais grillé. Grillé
!
Tenir. Il fallait tenir. Alors je me suis écrasé et
j’ai proposé de remettre un coup, comme si j’avais
quelque chose à me faire pardonner. À ma grande surprise,
les deux hurluberlus ont refusé. Refuser un coup ? Du jamais
vu. J’étais scié. Le René, il a même
eu le culot d’en remettre une couche. Il a grimacé
; oui, il a grimacé, le saligaud, en me livrant un jugement
sans appel :
- Non merci. Il est pas bon !
Puis il est sorti, le gars René, et il a craché un
gros molard plein de fiel dans une flaque.
Floc !
Tous
les midis, durant la semaine qui a suivi, j’ai vu défiler
un bataillon de cormorans à casquette du même acabit,
en solo, en doublettes ou en triplettes, comme au jeu de boules.
Comme un jeu, pour me foutre les boules. Et toujours la même
litanie : « Il est pas bon, ton Ricard, il a goût de
caoutchouc. » Ils s’étaient passé le mot.
Probable ! Y en a même un qui a essayé de me faire
croire que le nouveau système lui avait causé des
maux d’estomac ! Si bien que j’ai dû céder
: j’ai enlevé les doseuses et j’ai conservé
les mauvaises habitudes d’Armand de servir le petit jaune
un peu chargé. Double dose, au moins ! Triple, pour être
sûr de pas essuyer leurs critiques. Ils m’ont bien eu,
les anciens, avec leurs cerveaux en apparence endormis qui, en fait,
mijotaient sous leurs casquettes. Tenir. Il allait falloir tenir.
Et si je croyais devenir de but en blanc patron de bistrot de haut
niveau, les vieux habitués m’ont fait redescendre sur
terre. Ils m’ont fait comprendre dès le premier jour
que j’allais être soumis à rude épreuve.
Ça m’a fait marrer qu’à moitié.
En biais. On aurait dit la Joconde. En plus niais.
Et durant l’après-midi, alors, mon premier après-midi
de tenancier, eh bien, j’ai trouvé le temps long, très
long, à attendre l’apéro du soir en regardant
tomber la pluie. Je découvrais la solitude du patron de débit
de boisson attendant désespérément la venue
du pochetron. J’essuyai quelques verres pour m’occuper.
Je briquai le comptoir pour la énième fois. Par la
fenêtre, je regardai la cour balayée par le vent, les
poules qui picoraient, les nuages qui s’amoncelaient. Les
dépressions qui succédaient aux dépressions.
Croâ ! Croâ ! craillaient ces putains de corneilles
!
Faut
dire, y avait de quoi s’inquiéter. L’établissement
était situé dans les terres, en rase campagne, au
bord de la grand-route, à la limite des trois départements
et au croisement de deux chemins vicinaux que plus grand monde n’empruntait.
Peut-être deux douzaines de voitures par jour, un peu plus
quand c’était jour de marché au chef-lieu de
canton. Le trafic augmentait un tantinet durant la nuit, car en
suivant un subtil réseau de rébines, on pouvait atteindre
les bourgades voisines en évitant les contrôles biniou
de la gendarmerie. Tapi derrière mon comptoir en angle néo-rural,
dernière réalisation du dernier menuisier du pays,
vert sur le devant et rouge sur le dessus, conçu pour une
clientèle à dominante masculine de race Bretagne centrale
quarante-cinq ans et plus, je prenais la réalité en
pleine poire : à l’image de l’histoire de cet
arrière-pays, les heures de gloire du commerce local appartenaient
au temps passé.
Je
sais... J’aurais mieux fait de réfléchir avant
de me décider. Mais tu m’as poussé, Armand.
Non ? Tu m’as pas poussé, peut-être ? Même
un petit peu ?...
Alors ? Tu le bois ce verre de pinard, oui ou non ?... Si tu le
bois pas, il est pour moi !... Et voilà !
Tenir...
Peut-être
que je me suis laissé griser. Peut-être que j’avais
trop envie de croire que c’était mon destin. Dans le
fond, je n’étais pas fait pour tenir… La preuve
? Dès le jour de l’ouverture, je me suis mis à
douter… Heureusement qu’Armand m’a secoué
les puces, en fin d’après-midi, quand il est venu me
donner un coup de main pour passer mes commandes. Dans la foulée,
Marion a débarqué avec Morgane, notre fille, après
la sortie de l’école. Marion avait un caractère
en acier trempé. Elle m’avait tiré de la vase.
Je ne voulais pas la décevoir. Et Morgane, huit ans, c’était
que du bonheur, un joli cadeau de la vie. Le souvenir s’estompait,
de cet autre enfant que nous avions perdu à la naissance.
Petit à petit, la blessure cicatrisait.
Devant ma petite famille, j’ai tenté de faire illusion,
en mec enjoué. En réalité, je voyais approcher
avec soulagement l’heure de l’apéro. Et dès
qu’elle a sonné, je me suis piqué le nez avec
mes copains, pour marquer le coup et masquer le coup de blues. On
a bien rigolé, quand je leur ai raconté l’histoire
des doseuses.
Sieste
La
porte grince sur la crapaudine. J’entre dans le chai. Je renifle
à la bonde des barriques. Cela fait un mois que nous avons
procédé au pressage et à la mise en fûts.
Je colle mon oreille. Bloup bloup... Quel bonheur de constater que
le vin travaille pendant que je me repose ! Hum… Je m’allonge
dans la paille, les narines flattées par un merveilleux mélange
de vinasse et de moisissure. Des poules picorent autour de moi et
gloussent tendrement. Que c’est bon, ce demi-sommeil…
Rrrrr… J’aime la sieste. Ce temps pour rien. Et c’est
vrai que le temps passe moins vite, depuis que je fais la sieste.
Rrrrr… Parfois, j’ai même l’impression qu’il
s’arrête. Rrrrr… Armand avait bien raison, quand
il nous traitait d’agités du bocal. Il est bon qu’une
journée ressemble de nouveau à une journée,
et non plus à cette incessante course contre la montre que
seul un mur peut stopper, un accident d’auto, une catastrophe
vasculaire ou météo, planétaire ou perso. Et
c’est bien agréable, de prendre le temps de réfléchir.
Rrrrr… Cela vient naturellement, dès qu’on en
prend le temps, mais pas tout à fait comme la plante vient
au fossé, l’arbre au talus, le lapin au terrier. Cela
vient plutôt comme vient un jardin. Cela vient en contemplant
l’ordre des choses, et le désordre aussi. Cela vient
en grattant la terre pour y semer. Cela vient comme la philosophie
vient à l’esprit de celui qui se pose et se gratte.
Cela vient comme l’intelligence au nomade du désert,
confronté à l’immensité. Cela vient comme
l’esprit vient au vin : fragile honnêteté du
vigneron, rencontre entre la terre, le climat, le monde et le doute
qui nous habite. Rrrrr… La philosophie est un jardin, la pensée
un pas dans l’allée, et je réalise à
quel point l’agitation fébrile qui nous a aveuglés
durant tant d’années n’était qu’une
danse macabre. Une danse macabre au bord de ce canal qui va du néant
au néant. Du néant au néant se reflétait
cette image de nous-mêmes que nous prenions pour nous. Tant
d’hommes, de femmes et d’automobiles s’y sont
noyés. Cette agitation dénotait tous les efforts consentis
pour oublier notre trouille viscérale de la mort. Et plus
nous nous agitions, plus nous accélérions sa venue.
Il m’est arrivé, comme à d’autres, de
concevoir le monde comme un vaste échangeur autoroutier :
il me fallait des moteurs aux fesses pour aller plus vite que le
temps. On essayait de nous faire considérer comme un handicap
le fait d’habiter à la périphérie, très
loin de la première bretelle. Rrrrr… A présent,
je conçois le monde comme un jardin, avec des perspectives
où porter le regard, des paysages pour stimuler la pensée,
même si notre jardin de Ty Philo reste à inventer,
pour que le temps y soit mieux freiné, suspendu, cultivé.
Je rêve d’un jardin andalou. J’y vois déjà
tourner la danse, la spirale d’une gavotte périphérique,
captant l’énergie des habitants du bord du monde, éloignés
de ces trous noirs où l’ambition engendre le «
rien ». Je n’irai jamais vers le centre du cercle. Car
au centre, je sais qu’il n’y a rien. Rrrr... Rien !
Nomades
Quand
les roulottes s’en vont, nous nous accrochons, nous montons
par grappes sur les marchepieds, pour faire quelques mètres
en compagnie de nos amis, et quand il faut mettre pied à
terre, nous leur tenons la main le plus longtemps possible. Nous
agitons les mains. Nos mains sont des nuées d’oiseaux
incapables de s’envoler. Cloués au sol. Nous sommes
de la race maudite des cloués au sol, anciens oiseaux aux
ailes rabattues en robes de gitanes, anciens oiseaux aux oreilles
alourdies de boucles, aux poignets encombrés de bijoux. Incapables
de décoller, nous agitons des mouchoirs ridicules en guise
d’ailes, à présent. Et les nomades ont des yeux
qui leur poussent derrière la tête, à force
de vouloir rester alors qu’ils sont en train de partir. L’appel
de la route est plus puissant que tout. Plus fort que l’amour
et que l’amitié. Pourquoi resteraient-ils défendre
une maison, un bistrot, un mode de vie qui n’est pas le leur
? Les roulottes finissent par disparaître dans le virage,
là-bas, sur la vieille route rapiécée. Alors,
le monde n’est plus qu’un grand silence. Le monde n’est
plus qu’un grand vide que l’on cherche désespérément
à meubler de notre tristesse. L’oiseau qui chante sur
sa branche, on a envie de lui tordre le cou. Ferme-la ! Dans une
autre vie, nous étions nomades. Oiseaux. Tous. Dans une autre
vie, nous serons à nouveau nomades. Tous. Oiseaux.
Répression
Une
heure avant le lever du sixième jour, un fracas épouvantable
nous arrache les tympans et les tripes. Chacun d’entre nous
roule à terre, se tenant la tête à deux mains.
Nous n’avons pas le temps de comprendre et encore moins la
possibilité d’utiliser nos armes. Une musique. Du hard
rock. Les flics ont branché une sono surpuissante. Nous n’entendons
ni les vitres casser, ni les fumigènes tomber sur le plancher.
Déjà, la fumée nous prend la gorge. Tout va
très vite. Les portes explosent, les fenêtres se brisent,
les assaillants sont déjà sur nous, leurs casques,
masques à gaz, matraques, leurs bottes, la haine froide,
professionnelle, haine qui s’abat sur nous, haine qui n’est
que la haine tissée par leurs supérieurs, haine mijotée
à petit feu par ceux qui dominent et n’envisagent pas
d’arrêter de dominer, haine contenue, avant d’être
lâchée en meute de chiens affamés. La haine
du parti de la haine. Les flics nous tabassent mécaniquement,
comme des robots. Sans émotion. La haine, c’est juste
leur boulot. Ils me projètent au sol, me plaquent la tête
contre le plancher, l’écrasent sous leurs bottes, me
tirent les bras en arrière. Je suis un poulet désarticulé
à qui ils enfilent des menottes. Le goût du sang dans
ma bouche. La douleur. Les doigts écrasés sous leurs
pieds. Les bras dans le dos, ils me relèvent et me jettent
en avant en me retenant par la chaîne. Les menottes me tordent
le poignet et cisaillent la chair. Je hurle et je m’entends
même pas hurler. Toujours le rock infernal qui couvre les
cris, les voix, les plaintes, le hurlement des guitares saturées
qui annihile toute trace d’humanité.
Ils nous traînent dehors, à présent. Je ne sens
plus mes jambes, mais je suis encore conscient. Que se passe-t-il
? Le silence. Le vent froid mord mes plaies. Je suis un mouton saigné
pour l’Aïd. Et ce silence étrange. D’ailleurs,
est-ce vraiment le silence ? Je ne sais pas. Mes oreilles sifflent,
me font souffrir. Je n’entends pas piailler les oiseaux du
petit matin. Je suis sourd. Je ne vois rien, non plus, mais je crois
que c’est du sang, qui me coule dans les yeux. Je pèse
une tonne et je tombe sans un cri. La douleur, pourtant. La douleur,
encore. Je sens le métal froid contre ma joue, et je devine
d’autres corps inertes qui tombent autour de moi. C’est
ça. On balance nos carcasses saignantes dans des paniers
à salade, des containers, des poubelles, peut-être...
La vibration du moteur d’un camion. Les cahots, sur la route
rapiécée. L’accélération sur la
voie rapide. Je comprends qu’on nous emmène. Je voudrais
me frotter les yeux, nettoyer mes paupières collées.
Mes mains sont attachées dans mon dos. Mes poignets me font
mal. Une douleur chasse l’autre. Je parviens tout de même
à entrouvrir un œil. Je devine en face de moi une paire
de bottes et sur le côté, une main sanguinolente. Une
main de femme. Maigre. Je pense que c’est Gwen. J’essaie
de marmonner quelque chose, et je prends un coup de botte dans les
reins. Je crie, cette fois. Il remet ça. Je me tais. Toujours
ce sifflement, dans mes oreilles. J’entends. Mais ça
ne me rassure même pas, de n’être ni aveugle,
ni sourd. Maintenant, un flic me plaque un pied sur les côtes
et l’autre sur la cheville, il appuie de tout son poids mon
dos contre une barre de fer. Le trajet me semble interminable. Corps
meurtri. J’ai peur, je tremble, mais je récupère
un peu d’énergie que j’utilise pour essayer de
faire le point. J’ai l’impression d’avoir le poignet
brisé, une épaules démise. Je mange de la boue.
On nous extrait du fourgon. Je boîte, mais je marche. On me
tire par un bras, et ça me déchire. Je proteste et
ma voix sort de ma bouche pleine de bouillie :
-
Vous n’avez pas le droit ! Vous me cassez le bras !
- Arrête de gémir, espèce de tapette ! C’est
rien par rapport à ce qui t’attend !
Ils
me jettent sur le sol, me râpent la tête sur le goudron,
me tirent les cheveux, me tordent et me frappent, me traînent.
Quand ils fatiguent, ils me plaquent à terre, un genoux dans
le dos. Autour de moi, ceux qui ne peuvent marcher sont traînés
sur le sol, par les pieds, par les jambes, par un bras. Leur peau
ripe sur le bitume.
J’entre dans un bureau. Je suis dans un état lamentable.
La femme qui pose les questions a les ongles vernis en rouge. Nom
du père, de la mère... Un chignon. Tirée à
quatre épingles. Elle me vouvoie. La violence physique fait
place au mépris. Je demande qu’on m’ôte
les menottes qui m’entaillent les poignets et qu’on
appelle un docteur. La femme-flic me dit de cesser de pleurnicher,
que j’aurais mieux fait de réfléchir avant de
faire le con. Je proteste mollement. Elle fait semblant de ne pas
trouver les clés, et fait traîner le plus longtemps
possible, avant de s’exécuter, enfin. Quand on me déverrouille,
je ne sens plus ma main droite. Deux flics viennent me chercher.
Ils me poussent dans une pièce aveugle. L’un d’eux
m’annonce : « Fouille intégrale ». Après,
il gueule : « Allez ! à poil ! » J’ai beaucoup
de mal à me déshabiller, à cause de la douleur,
dans la main. « Plus vite que ça ! Baisse ton slip,
pédé ! » Tiens ! on me tutoie, de nouveau. Quand
un flic te tutoie, tu sais tout de suite que ce n’est pas
pour faire copain-copain. Ils font l’inventaire de ce qu’ils
trouvent dans mes poches, et l’enferment dans une petite boîte.
Toutes les paroles, tous les détails semblent se graver à
vie dans ma mémoire, comme lors des précédents
interrogatoires, d’ailleurs, que ce soit avec les flics ou
avec les douaniers. Il y a longtemps, mais je n’ai rien oublié.
Après la fouille, ils me jettent dans une petite cellule
de deux mètres sur deux. Une couchette grise est vissée
au mur. Les murs sont tagués, couverts de graffitis et de
merde. Rachid, Ahmed, Brahim, Goran, Marcel... C’est raide,
mais je sais que si j’étais noir ou vraiment arabe,
je me serais fait cogner encore plus fort. Ça sent la pisse.
J’ai soif. Pas d’eau. Pas de robinet. Je m’allonge
sur la couchette, souillée de tâches de sang et d’excréments.
La lumière allumée en permanence. Combien de temps
? Je ne sais pas. Rien ne permet de distinguer le jour de la nuit.
La douleur m’empêche de dormir. Et la lumière
dans la gueule, aussi. Tout cela est sans surprise. Bienvenue dans
les geôles françaises, mondialement connues. Quand
tu te fais gauler à l’étranger et que les autres
détenus apprennent que t’as fait de la taule en France,
c’est total respect. On te traite en héros, comme si
t’avais échappé aux geôles d’Hassan
II. Je souris, en pensant à mon engagement non-violent. Je
devrais en être fier, mais je trouve ça stupide, tout
d’un coup, d’avoir été vaincu sans combattre.
J’ai envie de chier. J’appelle, mais personne ne vient.
Je tape contre la porte pour me faire entendre. Toujours personne.
Je cogne aussi fort que je peux, avec le pied gauche, le plus valide.
Un gardien surgit. Il a l’air furieux, échevelé.
-
J’ai besoin d’aller aux chiottes.
Il me répond :
- Pas possible. Y a une coupure d’eau.
Il a envie de cogner, ça se voit.
- Et je fais comment, alors ?
- Y a pas d’eau dans tout le commissariat, alors tu te la
coinces, compris ?
- Je vais être obligé de chier dans la cellule.
- Si tu fais ça, on te fait bouffer ta merde.
Pendant
toute la nuit, des cris me parviennent, provenant d’autres
cellules. Le béton, caisse de résonance. Des pas.
Des insultes. Des cris, encore. Tous ces bruits m’arrachent
les tympans. Après une nuit blanche, on vient me chercher,
pour prendre mes empreintes et tirer mon portrait. De face, de profil,
avec un petit écriteau. Forcément, avec le visage
tuméfié, je dois avoir une gueule de tueur. On m’autorise
enfin à aller aux toilettes. Puis on me pousse dans le bureau
d’un OPJ qui me communique la raison de mon arrestation :
constitution de bande organisée, participation à une
entreprise terroriste, vols, dégradations, recel, incitation
à l’émeute et violence envers des dépositaires
de l’autorité publique. Rien que ça ! Je retourne
au trou, pas dans la cellule de garde-à-vue, cette fois,
mais dans un cachot glacial, avec des chiottes à la turque
et un matelas avec des cartes de France, d’où l’on
me tire sans ménagement, aux moments les plus inattendus
du jour et de la nuit, pour m’interroger. Sommeil haché.
Cauchemars. Et la réalité pire que les cauchemars.
J’applique au mieux les consignes : en dire le moins possible,
laisser les flics bouger un pion avant de daigner exprimer quoi
que ce soit qui puisse les faire avancer d’un pouce. On m’a
refilé un avocat à la ramasse, un alcoolo qui n’est
là que pour vérifier la régularité des
interrogatoires et pour s’assurer qu’on me nourrit correctement.
Je me refais une santé, c’est vrai. Le toubib de service
y veille très méticuleusement. Sa mission est simple
: il faut qu’après mes six jours de garde-à-vue,
je ne présente aucune séquelle du tabassage auquel
j’ai été soumis. Un vrai sorcier, dans le genre,
même si c’est tout ce qu’il sait faire, réparer
des momies. Bigleux. Méticuleux. Il m’enveloppe de
bande Velpeau. C’est le genre de type qui serait capable de
faire passer Toutankhamon pour un grimpeur colombien échappé
sur le Tour de France !
Exil
Notre
exil n’annonce pas notre défaite. Loin de là.
Je ne sais pas s’il prépare notre retour et encore
moins un retour victorieux. Et d’ailleurs, une victoire sur
qui, sur quoi ? Nous avons le temps. Tout notre temps. Lente érosion.
Tendre ironie. Comme le vin du vigneron, le temps travaille pour
les rebelles, pas pour les goinfres qui veulent tout et tout de
suite. Ex-île. L’exil est une île. L’exil
est une île qui n’attend rien de nous, contrairement
à ce qu’affectaient de croire nos ancêtres colons.
Nous n’arrivons pas en pillards, ni en donneurs de leçons,
cette fois. Ni en explorateurs, ni en réfugiés. L’île
n’est pas un refuge. L’île, c’est une émotion,
un ventre, des courants. L’île est un amer pour les
hommes en quête de liberté, qui ont en charge le cabotage
des idées. Et puis, l’île est une porte, et cette
porte peut bien s’ouvrir sur l’Inattendu.
|
 |